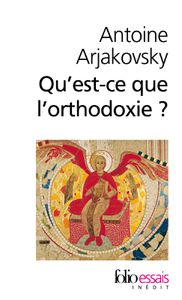 Permettez-vous de reprendre votre propre question "Qu’est-ce que l’Orthodoxie" ?
Permettez-vous de reprendre votre propre question "Qu’est-ce que l’Orthodoxie" ?
Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Si Orthodoxie porte un O majuscule, on désigne le plus souvent une réalité ecclésiale. Mais précisément les historiens hésitent de plus en plus à identifier cette Orthodoxie à l’Eglise Orthodoxe comprise au sens confessionnel du terme. C’est ce dont témoignent aussi de nombreux auteurs du XXe siècle comme le père Serge Boulgakov par exemple qui dans son livre L’Orthodoxie en 1932 commence par les phrases suivantes : « L’Orthodoxie est l’Eglise du Christ sur la terre. L’Eglise du Christ n’est pas une institution, elle est la vie nouvelle, avec et dans le Christ, mue par le Saint Esprit. »
En effet les théologiens du XXe siècle ont constaté qu’il était très difficile d’assigner des frontières à l’Eglise du Christ. Comment le faire quand le Christ Lui-même assure à ses disciples que lorsque deux ou trois seront réunis en son nom Il sera au milieu d’eux ? (Mathieu 18, 15-20) Selon cette définition une simple famille qui invoque le Christ forme l’Eglise. On est loin ici d’une définition classique de l’Eglise.
Il y avait donc matière à tirer tous les enseignements de cette prise de conscience fondamentale qui a grandi tout au long du XXe siècle chez de nombreux chrétiens. Il fallait en particulier concevoir un récit post-confessionnel de l’Eglise. Très sincèrement j’ai le sentiment que, au moins du point de vue des chrétiens orthodoxes, mon livre « Qu’est-ce que l’orthodoxie ? » (Paris, Gallimard, 2013) représente un premier essai de rédaction d’une telle histoire.
Pour ce faire il a fallu tirer les enseignements de cette profonde évolution de l’ecclésiologie (elle-même certainement influencée par le mouvement des grandes migrations du XXe siècle et également par le désir de sortir d’une idéologie moderne mortifère) au plan des relations entre la « foi » et la « raison ». Jusqu’il y a peu, dans les milieux sécularisés, on considérait que l’orthodoxie avec un o minuscule n’avait pas grand-chose à voir avec l’Orthodoxie avec un O majuscule. On disait par exemple de telle opinion qu’elle était « peu orthodoxe » pour désigner d’une façon générale une pensée déviante par rapport à une règle. Qu’il s’agisse de la cuisine nouvelle ou des thèses d’Amartya Sen sur l’indice du PIB on avait à faire à l’hétérodoxie.
La raison de cette semoule sémantique est qu’au XVIe siècle s’est produite une fracture profonde entre la « foi » et la « raison ». On pourrait même dire que cette fracture eut lieu dans certains esprits dès le IVe siècle. Mais elle est devenue dominante ou paradigmatique à partir des nouveaux récits d’histoire de l’Eglise qui apparurent avec la Réforme et la Contre Réforme. L’explosion de la communion d’amour qui existait entre les chrétiens a entraîné avec elle l’intelligence de l’orthodoxie comme vérité droite, comme structure intelligible capable de penser ensemble la vérité de la révélation, l’identité commune, la morale personnelle et l’horizon du royaume. A partir de Flavius Illyricus, César Baronius et Dosithée de Jérusalem l’orthodoxie n’est plus comprise que comme la mémoire fidèle à une norme. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire qu’une telle évolution du sens de l’orthodoxie se produit. Lors des quatre premiers siècles du christianisme en effet être orthodoxe signifiait avant tout louer Jésus Christ comme puissance et sagesse de Dieu. Pierre le dit dans sa première épître : « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière… » (Pierre 2,9)
Aujourd’hui cependant l’étude approfondie des nouvelles histoires de l’Eglise montre qu’un nouveau sens de l’orthodoxie émerge, celui de la connaissance juste. L’orthodoxie signifie de moins en moins une appartenance à une institution ou à une chapelle mais de plus en plus la capacité à faire ce que l’on dit et à dire ce que l’on fait. Cela signifie également que disparaît actuellement aussi la conception séculière de l’orthodoxie comme concept neutre détaché de tout contenu et signifiant simplement l’adéquation à une norme. On comprend mieux que la norme ne peut être une réalité stable s’il n’y a plus de référent symbolique à l’ensemble des normes. Ainsi par exemple que signifie être un libéral orthodoxe lorsqu’on étudie l’évolution du libéralisme depuis la révolution française. Quel est l’étalon du libéralisme ? Et comment justifier la disparition du référent transcendant au libéralisme après Tocqueville ?
- Si une personne vit selon ces 4 principes, est-elle orthodoxe quelle que soit sa religion ?
Si l’on entend l’orthodoxie comme indice de la qualité de la foi religieuse, alors comme je vous le disais de plus en plus on se réfèrera à l’authenticité du style de vie pour désigner quelqu’un d’orthodoxe ou non. Mais vous avez raison d’insister sur le fait que la pensée doxique repose sur une structure plus complexe, à savoir sur une capacité personnelle et donc communautaire à tenir ensemble la juste glorification, la mémoire fidèle, la vérité droite et la connaissance juste. Les grandes religions sont souvent partagées par des courants divergents. Pour retrouver leur unité et leur cohérence elles devront retrouver cette structure universelle de l’intelligence spirituelle. La réconciliation entre sunnites et shiites par exemple ne repose pas uniquement sur un travail historique portant sur la mémoire originelle de l’islam.
J’attire votre attention sur le fait que le christianisme ne se comprend pas comme une « religion » à proprement parler. Jésus Christ a répondu à la Samaritaine (Jean 4) que l’adoration de Dieu ne peut se réaliser qu’en esprit et en vérité. Cela signifie que le christianisme transcende les religions. Il les transforme toutes de l’intérieur. Il pose que la juste glorification, la mémoire fidèle, la vérité droite et la connaissance juste sont indissociables de la révélation du Christ comme vrai Dieu et vrai homme, et de Dieu comme Père, Fils et Saint Esprit. Il s’agit d’une ekklesia catholica, d’une communauté vivant selon le tout trinitaire, ouverte donc à tout le genre humain.
La pensée doxique est donc bien différente de la pensée scientifique qui conceptualise en fonction de critères pré-déterminés comme le contenu doctrinal et la vérification homothétique de l’expérience. La pensée épistémique fait jaillir la vérité par le travail d’objectivation à l’égard de tous les a priori, de détachement du monde de l’intelligence, et d’universalisation des données de sa propre expérience par la conceptualisation abstraite d’un phénomène. La pensée doxique a longtemps été ignorée voire méprisée par la philosophie et par la théologie académique en raison de son manque de permanence, de sa dépendance à l’égard de la pensée d’autrui, de sa trop grande proximité avec la mythologie. Elle requiert en effet une ouverture à ce qui dépasse notre entendement et puise dans toute forme de symbolisme. Elle s’appuie sur l’amitié comme source de l’intelligence. Elle n’est donc pas immédiate et saisissable de façon individuelle. Elle comprend l’amour de la sagesse comme un cheminement unissant la vérité et la vie.
La foi est la synthèse entre la pensée épistémique et la pensée doxique. En effet dans la lettre aux Hébreux Paul la définit à la fois comme « la garantie des biens que l’on espère » et « la preuve des réalités qu’on ne voit pas ».
- Nous avons l’habitude d’utiliser le mot « orthodoxie » pour désigner une religion. Vous nous le présentez sous un nouveau sens. Ça pourrait porter à confusion ? Pourquoi ne pas « inventer » un autre mot?
D’abord il faut rappeler que ce phénomène de désigner une « religion » par le qualificatif « d’orthodoxe » est récente. Elle ne date que du XVIe siècle. Et jusqu’au milieu du XXe siècle elle n’était pas acquise. En effet les « orthodoxes » ont continué à désigner leur Eglise comme « catholique » jusqu’à aujourd’hui (cf la traduction en français par « catholique » du terme slavon « sobornaja », qui fut lui-même une traduction du terme grec « katholica »).
Pierre Mohyla en Ukraine au XVIIe siècle a écrit une Confession de foi à destination des « orthodoxes-catholiques ».
La vraie confusion consistait en réalité à attribuer l’orthodoxie à une seule famille d’Eglises au nom d’une identification des frontières de l’Eglise avec l’intelligence de la foi. Il est heureux que cette période, théorisée par Vladimir Lossky, prenne fin. C’est je crois l’un des apports principaux de mon livre d’aider à prendre conscience.
Et au contraire je crois que le temps est venu pour les Eglises orthodoxes d’expliquer pourquoi elles pensent avoir le monopole de la vérité. D’un point de vue chrétien « orthodoxe » les « catholiques » ont peut être tort de penser que le pape est « infaillible ». Mais les « orthodoxes » ont également tort de ne pas être en mesure de se réunir en concile depuis plusieurs siècles ! Il y a tellement de sujets qui mériteraient de recevoir un éclairage conciliaire puisque telle est la gnoséologie chrétienne « orthodoxe ». Mais depuis au moins 3 siècles pas une parole de vérité commune n’a pu jaillir des Eglises orthodoxes sur la question du calendrier commun ou sur celle des totalitarismes… Il faut admettre ce fait avant de prétendre au monopole de la vérité.
J’ajoute que ce travail de redécouverte de l’orthodoxie de la foi comme synthèse de la doxa et de l’épistémè ne concerne pas uniquement les différentes chapelles du christianisme. Il concerne également les pensées dites agnostiques et modernes qui se pensent émancipées des choses en soi par le simple fait qu’elles aient cessé avec Kant de vouloir connaître celles-ci. Il suffit d’un minimum d’honnêteté intellectuelle pour le reconnaître. C’est le mérite d’un philosophe chrétien orthodoxe de tradition slave Vladimir Soloviev de l’avoir montré le premier. Nicolas Berdiaev, qui est né à Kiev comme vous le savez a réalisé le même travail à l’égard de la philosophie existentielle de son temps. Y aura-t-il un penseur contemporain capable d’aider les Ukrainiens d’aujourd’hui à se défaire de leurs fausses certitudes ?
- L’orthodoxie dans ce nouveau sens se rapproche de l’œcuménisme. En quoi l’œcuménisme est important et particulièrement dans le contexte ukrainien?
Oui cette redéfinition sémantique participe à la redécouverte que les frontières de l’Eglise du Christ sont infiniment plus larges que les frontières institutionnelles des Eglises dites catholiques, orthodoxes ou protestantes.
Le mouvement œcuménique est important pour le monde car il actualise les dernières paroles du Christ avant son arrestation : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée pour qu’ils soient un comme nous sommes un » (Jn 17, 22). Ce mouvement historique inter-ecclésial correspond donc à la réalité d’un échange de gloire permanent entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint comme l’atteste ce verset. Il a une particulière importance en Ukraine. Car l’Ukraine est sortie profondément blessée par sa douloureuse histoire à l’époque moderne. La guérison de ses blessures intra-ecclésiales lui permettra de guérir de ses blessures identitaires et linguistiques.
Je suis également convaincu que si les chrétiens ukrainiens parvenaient à actualiser leur « idée historique » de « l’Eglise de Kyiv » théorisée par de grandes figures telles que le métropolite Mohyla ou au XXe siècle le métropolite Sheptytsky, à savoir une Eglise en triple communion avec Rome, Moscou et Constantinople, elle permettrait à l’ensemble du monde chrétien à faire un pas de plus vers l’unité (et j’inclus bien évidemment dans ce processus les Eglises issues de la Réforme). L’Eglise grecque catholique ukrainienne longtemps vilipendée par les « orthodoxes » de Moscou est en réalité une chance pour l’avenir car elle dispose d’une triple identité : orthodoxe par sa foi (comprise dans tous les sens du terme), catholique par sa fidélité à l’évêque de Rome (comme ce fut le cas depuis le concile de Florence en 1439 à la différence des autres Eglises), et protestante par son avènement à l’âge de la Réforme (c’est-à-dire par sa résistance à toutes les injonctions de la rationalité sécularisée).
Je me suis réjouis que le président Youshenko en 2005-2010 ait été aussi attentif à cette question à la fois ecclésiologique et géo-politique. Il a échoué car il n’a pas cru à ce modèle post-national d’une Eglise dont le principe d’unité ne serait pas uniquement le territoire mais d’abord l’union du peuple de Dieu à son pasteur divino-humain.
- Il y a quelques années vous avez publié le livre « En attendant le concile de l’Eglise Orthodoxe». Vous l’avez fait traduire en ukrainien. Comment le livre fut-il accueilli en Ukraine ? Comptez-vous faire traduire en ukrainien le livre qui vient de paraître ?
Ce livre « En attendant le concile de l’Eglise Orthodoxe » est paru en 2011 en France aux éditions du Cerf. Il est déjà traduit en russe et en ukrainien. J’espère qu’il va être publié cette année aux éditions de l’Université catholique d’Ukraine à Lviv. C’est un livre qui consacre plus de 150 pages à la situation politique, spirituelle et religieuse de l’Ukraine. J’ai souhaité que ce livre soit lu en Ukraine et en Russie car d’une part j’ai énormément reçu de ces deux pays pendant les vingt années où j’y ai vécu successivement. Et d’autre part j’ai pris conscience que la plupart des freins au dynamisme de la vie ecclésiale en Ukraine reposent sur un manque de connaissance du travail réalisé dans le monde en philosophie, théologie, ecclésiologie, etc…
J’ajoute qu’il s’agit d’une série de conférences que j’ai données un peu partout dans le monde et que partout mes idées ont été en général très bien accueillies. L’une de ces idées est que l’Eglise Orthodoxe doit prendre conscience qu’elle a une responsabilité historique, et que cette responsabilité est méta-nationale. D’où mon insistance sur l’importance de cet horizon du concile œcuménique réunissant l’ensemble des Eglises Orthodoxes. Cet horizon doit se transformer en actualité si les Eglises ukrainiennes veulent avoir une chance de peser sur les destinées du monde. En proposant leur modèle d’Eglise locale en double communion l’Eglise de Kiev réconciliée pourrait bouleverser l’ordre du jour du concile et apporter une contribution définitive non seulement à l’ecclésiologie mais aussi à la science politique post-moderne. Il y a en effet un lien étroit entre les théories modernes de l’autocéphalie et de l’Etat-nation.
Il est heureux que l’Ukraine cherche à se constituer comme Etat-nation après tant d’années de déni de son identité plurielle par les grands empires qui la bordent. J’ai essayé moi-même de contribuer, lorsque je vivais à Kiev puis à Lviv, à faire comprendre la réalité de cette identité ukrainienne et européenne à mes compatriotes. Mais il est nécessaire qu’aujourd’hui les Ukrainiens se projettent un peu plus dans l’avenir. La globalisation ne permet plus aux nations de vivre repliées sur elles-mêmes. Et surtout les progrès du christianisme œcuménique et de la pensée contemporaine la plus authentique ont mis en valeur la notion de personne comme horizon de notre post-modernité. La personne est une notion hiérarchiquement supérieure à la notion de nation. D’un point de vue chrétien elle seule a été créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. D’un point de vue humaniste elle seule est parvenue à vaincre l’oppression des Etats totalitaires. C’est au nom des droits de la personne que la révolution orange a pu résister en 2004 au système souverainiste, anti-personnaliste et anti-démocratique de Léonide Koutchma.
C’est pourquoi, sans vouloir donner en aucune manière de leçon – car je sais combien la France et l’Union européenne souffre d’une profonde crise morale - les Ukrainiens doivent réaliser que le rejet par la population des principes éthiques et personnalistes de la démocratie risque réellement de leur faire perdre leur souveraineté. L’Ukraine est en effet un pays qui souffre d’une large corruption. De nombreux indicateurs sur la santé physique de la nation ukrainienne sont au rouge. L’exil des élites est également un danger pour l’avenir du pays.
D’un point de vue chrétien l’horizon d’une nation souveraine ne peut se limiter à elle-même, il doit nécessairement participer à l’établissement du royaume de Dieu sur la terre. C’est même cet aiguillon de vérité-justice, de pravda, qui représente le meilleur de ce que la culture ukrainienne a produit de Iaroslav le Sage à nos jours. A titre personnel je pense que cet horizon de justice devrait pousser les Ukrainiens à se mobiliser beaucoup plus pour la libération de tous les prisonniers politiques qui remplissent les geôles ukrainiennes, à commencer par Youlia Tymoshenko.
S’ils parvenaient les premiers à retrouver cette hiérarchie des valeurs qui pose la primauté de la dignité humaine, ils pourraient alors aider les démocraties occidentales à se sortir de leur profonde crise morale et spirituelle. Une crise dont les Ukrainiens n’ont pas à mon avis encore pris toute la mesure.
Propos recueillis par Valentyna Coldefy




 C ’est dans les salons de la Mairie du 6ème arrondissement de Paris et sous la présidence de M. Jean-Pierre Lecoq, maire de cet arrondissement prestigieux, que Nathalie Pasternak, présidence du Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne de France
C ’est dans les salons de la Mairie du 6ème arrondissement de Paris et sous la présidence de M. Jean-Pierre Lecoq, maire de cet arrondissement prestigieux, que Nathalie Pasternak, présidence du Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne de France








 Descendant d’une grande famille poussée à l’exil par la révolution de 1917, Michel Terestchenko est de retour en Ukraine 85 ans plus tard. Aujourd’hui il y travaille avec succès dans l’agriculture, écrit des livres, fait du mécénat et a créé une fondation. Il a accordé un entretien à Perspectives.
Descendant d’une grande famille poussée à l’exil par la révolution de 1917, Michel Terestchenko est de retour en Ukraine 85 ans plus tard. Aujourd’hui il y travaille avec succès dans l’agriculture, écrit des livres, fait du mécénat et a créé une fondation. Il a accordé un entretien à Perspectives.  Emmanuelle Armandon est directrice des études de la formation en relations internationales de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Paris). Elle vient de publier « La Crimée entre Russie et Ukraine » aux éditions Bruylant.
Emmanuelle Armandon est directrice des études de la formation en relations internationales de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Paris). Elle vient de publier « La Crimée entre Russie et Ukraine » aux éditions Bruylant.